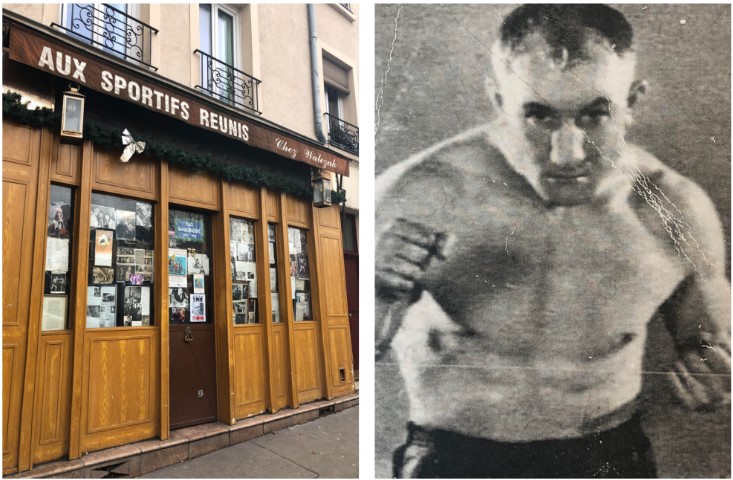Poutine, champion d’une géopolitique à somme nulle Par Alexandre Melnik
A l’exemple du football des années 1970, qui fut un jeu de onze contre onze gagné toujours à la fin par l’Allemagne, la géopolitique actuelle ressemble à une joute, qui implique de nombreux compétiteurs aux diverses intérêts, dont au final semble sortir toujours le même vainqueur – Vladimir Poutine. Le retrait militaire russe en Syrie en serait une nouvelle illustration. Comme trouve-t-il le fil d’Ariane dans l’inextricable enchevêtrement du monde moderne ? Gagne-il vraiment à tous les coups ou s’agit-il de victoires à la Pyrrhus qui ne font qu’aggraver les problèmes existants ?
Au premier abord, le Kremlin a atteint le triple objectif de son agenda caché en Syrie : d’abord, sauver le régime de Bachar Al-Assad, ayant le même ADN autoritaire que le pouvoir à Moscou ; ensuite, faire revenir la Russie sur le devant de la scène géopolitique pour se partager le monde avec les Américains (le « ça » du président russe, dont le logiciel mental est incurablement formaté par la guerre froide) et, enfin, remuscler, aux yeux de l’opinion russe, son image d’un leader qui, en cognant fort à l’étranger, restaure la grandeur de son pays et exalte sa ferveur patriotique, à un moment où l’économie nationale traverse une zone de turbulence. Sans oublier de détourner l’attention des agissements russes en Ukraine.
Mission réussie donc ? Pas vraiment. Car rien n’est toujours réglé, au fond, ni en Syrie, ni en Russie, ni à l’échelle globale.
Les djihadistes de Daech, épargnés par les frappes russes, sont toujours là. Pire : ils menacent de renforcer leurs attaques, en profitant du désengagement de Moscou, ce qui ne manquerait pas, à son tour, de provoquer un nouvel exode de migrants.
L’idée russe de « fédéraliser » la Syrie, avec une parcelle kurde au nord, une zone tampon entre la Turquie et l’Irak et une Syrie dite « utile », sous la férule d’un régime baasiste, réfractaire à la démocratie (avec ou sans Bachar Al-Assad), loin d’être une solution miracle, risque de générer un nouveau « conflit gelé », selon les vieilles recettes du Kremlin, déjà expérimentées sans succès en Transnistrie, en Ossétie et dans le Donbass.
Quant à l’économie russe, dont la relative prospérité des dernières années reposait exclusivement sur l’exportation de matières premières, sa descente aux enfers s’accélère tous les jours, sans qu’on puisse entrevoir une porte de sortie, car la Russie s’est délibérément déconnectée de l’économie globale d’aujourd’hui : aucun pôle d’innovation porté les start-ups numériques, aucune réforme en profondeur du système éducatif qui, au lieu de s’adapter aux nouvelles exigences du monde interconnecté et réticulaire du XXI siècle, s’est rigidifié sur ses fondamentaux datant de l’époque soviétique (absence de débat contradictoire et d’interactivité dans les relations professeurs – étudiants ; tarissement d’échanges universitaires avec l’étranger, etc.). Pourquoi aucune business school russe n’est visible dans les classements internationaux ? Qui peut expliquer au président russe, qui se croit le maître du monde, que la seule matière première qui ne s’épuise pas à l’usage, c’est la matière grise ?
En conclusion, les thuriféraires, nombreux en France, du « poutinisme botté » ne doivent pas oublier l’essentiel : l’apparent succès d’un homme qui peut faire tout ce qu’il veut à l’intérieur de son pays, un colosse aux pieds d’argile, est d’abord fonction de l’aboulie de l’Occident, empêtré dans les contradictions internes de ses régimes démocratiques. Du coup, le retrait russe en Syrie laisse un amer arrière-goût de gâchis, comme si c’était un illusoire jeu à somme nulle, préjudiciable à la recherche de solutions durables.
Alexandre Melnik (né à Moscou en 1958) est professeur à ICN Business School Nancy-Metz, expert et consultant en géopolitique, auteur, rédacteur en chef de lettres d’informations sur la Russie, ancien diplomate à Moscou.