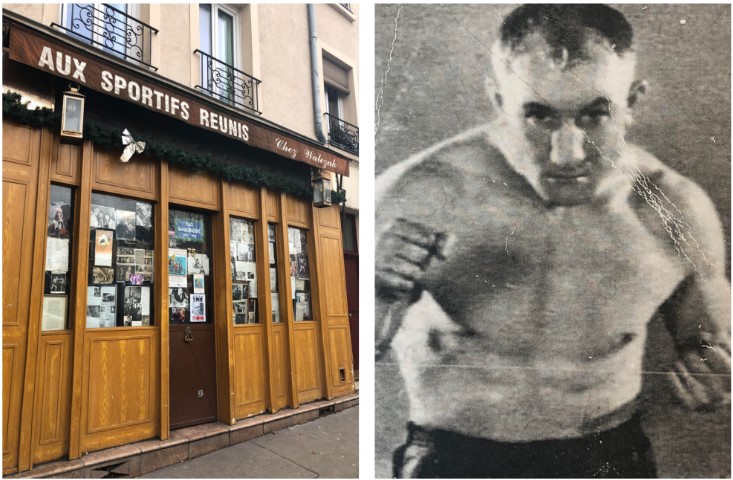Conseil de l’attractivité : les problèmes de droit du travail occultés
Le compte rendu des réunions de lundi et mardi entre le gouvernement mené par le Chef de l’Etat et les patrons étrangers, consacrées à l’attractivité de la France, n’a fait aucune mention quelle qu’elle soit d’une évocation des questions relatives au droit social et particulièrement au droit du travail. Ne s’est-il rien dit ? Et pourtant ces questions font régulièrement l’objet de commentaires, au même titre que la fiscalité, son niveau et son instabilité.
On se souviendra de la lettre ouverte de décembre dernier émanant des patrons de filiales étrangères, évoquant le problème des seuils sociaux et la flexibilité du travail. De même, une autre et très récente « lettre d’un startupper » signée de Jérôme Lecat, fondateur de Scality, une start-up française qui s’est implantée dans la Silicon Valley, insiste sur « l’image déplorable du droit social français », inadéquat particulièrement pour les start-ups. Ces dernières, est-il dit, sont fondées sur la prise de risque et l’obligation de pouvoir faire face à des restructurations importantes et soudaines, permettant de repartir du bon pied, alors qu’en France il faut déposer son bilan. Assez frappant est aussi l’affirmation qu’ « il faut deux fois plus de personnes en France qu’aux Etats-Unis pour assurer un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est la norme dans l’économie numérique », alors qu’en même temps le coût du travail n’est pas en cause puisqu’il est nettement plus élevé aux Etats-Unis : c’est donc de la flexibilité de l’organisation du travail qu’il est ici question.
Sur ces sujets, on sait que l’argumentation officielle du pouvoir s’en tient à ce qui a déjà été accompli depuis un an, en particulier avec l’ANI de janvier 2013, fruit du dialogue entre partenaires sociaux passé dans la loi en juin. Deux dispositions sont soulignées, à savoir, d’une part la possibilité de lier les salariés par un accord entre partenaires sociaux d’une entreprise, afin d’imposer un aménagement du temps de travail et des salaires en cas de circonstances exceptionnelles, et d’autre part l’homologation des plans sociaux par l’autorité administrative. Il s’en faut de beaucoup cependant que ces procédures suffisent à assurer la flexibilité nécessaire et que l’Etat puisse considérer que son travail ait été accompli au prétexte qu’il a accordé son imprimatur au résultat d’une négociation entre les partenaires sociaux.
Sur le sujet de la flexibilité, la première des dispositions évoquées (article 12 de la loi) est d’application très restrictive, entourée de nombre de procédures compliquées et subordonnées à pléthore de conditions. Surtout, l’accord des partenaires sociaux ne peut être que temporaire (2 ans au plus) et suppose l’existence de « graves difficultés conjoncturelles » (quid en cas de difficultés structurelles ??), ainsi qu’un retour à meilleure fortune lorsque ces circonstances n’existeront plus. Le ministère du Travail a publié un bilan des 8 premiers mois d’application, bilan dont il apparaîtrait que 8.360 entreprises auraient eu recours à la disposition qui facilite l’activité partielle [1]. C’est dans les TPE et les PME que l’utilisation de cette disposition s’est concentrée. On peut douter toutefois que les grandes et moyennes entreprises trouvent intéressant de s’en servir. En tout cas, on se souviendra que Renault est parvenu début 2013 à un accord sur le temps de travail assez historique avec les syndicats en ignorant superbement la négociation en cours, qui n’aurait d’ailleurs été d’aucune utilité puisque Renault a finalement négocié une augmentation du temps de travail (le retour à un vrai 35 heures), l’inverse du champ d’application de la disposition légale. Il en est de même des accords passés au sein de PSA.