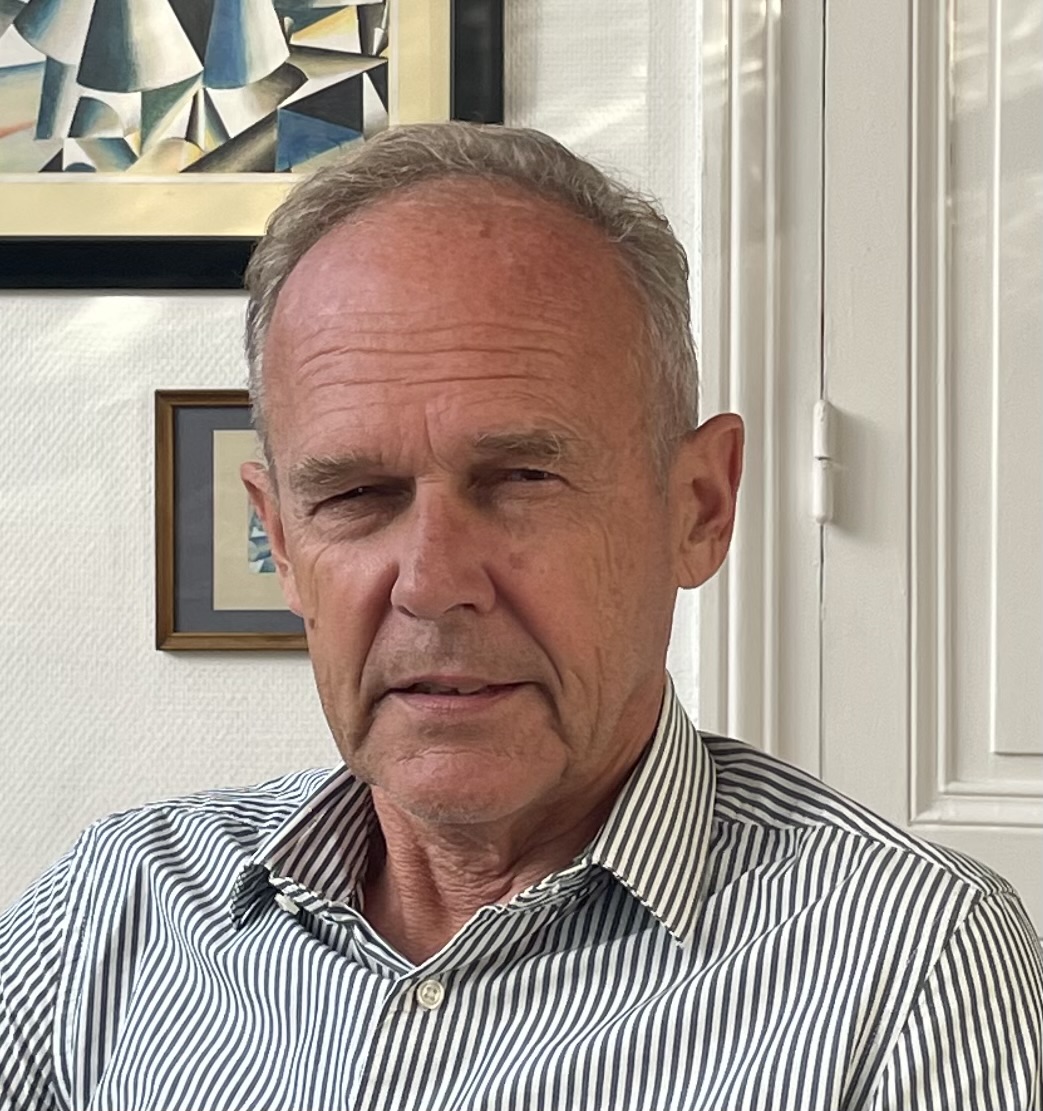Madagascar : la jeunesse face à l’épreuve du pouvoir Rajoelina
À Madagascar, l’immense majorité silencieuse a un visage jeune : plus de 60 % de la population a moins de 25 ans. Dans cette île-continent marquée par une pauvreté endémique et une instabilité politique chronique, cette donnée démographique n’est pas un simple détail statistique. Elle cristallise une interrogation centrale : cette jeunesse, aujourd’hui en marge des centres de décision, pourrait-elle devenir la force politique capable d’ébranler le pouvoir du président Andry Rajoelina ?
Une génération nombreuse mais captive
La jeunesse malgache est à la fois le cœur battant et le talon d’Achille de la nation. Promesse d’avenir, elle est aussi le miroir des impasses d’un État faible. Faute d’emplois, de perspectives éducatives et d’infrastructures, une large part de cette génération grandit dans un horizon réduit à la survie quotidienne.
Cette condition nourrit une double tentation : l’exil, réel ou fantasmé, et la résignation. La jeunesse malgache est nombreuse, mais politiquement entravée, prise dans un système clientéliste qui recycle les élites et verrouille l’accès à la représentation.
Le pouvoir Rajoelina et ses fragilités
Depuis son retour aux affaires en 2018, Andry Rajoelina incarne un pouvoir à la fois charismatique et contesté. S’appuyant sur un discours modernisateur, il a pourtant échoué à enrayer la spirale de pauvreté qui frappe plus des trois quarts de la population.
À cette fragilité économique s’ajoute un ressentiment croissant, en particulier parmi les jeunes urbains connectés aux réseaux sociaux, qui dénoncent les dérives autoritaires du régime. La figure présidentielle, longtemps associée à l’idée d’un renouveau politique, apparaît désormais comme l’illustration d’une continuité oligarchique.
Entre résignation et désir de rupture
L’histoire récente de Madagascar a montré que les mouvements de jeunesse peuvent précipiter la chute d’un régime : ce fut le cas en 2002, puis en 2009, lors de la première accession de Rajoelina au pouvoir. Mais aujourd’hui, la mobilisation reste parcellaire. Les manifestations étudiantes sont dispersées, vite réprimées, et les réseaux sociaux peinent à transformer l’indignation en action politique structurée.
Le pouvoir conserve, en outre, une capacité de coercition réelle : surveillance des opposants, arrestations préventives, contrôle des espaces publics. À cette peur s’ajoute une absence de leadership fédérateur au sein de la jeunesse, empêchant la cristallisation d’un mouvement collectif durable.
L’épreuve de la maturité politique
Reste une équation ouverte : cette jeunesse peut-elle, au-delà des protestations ponctuelles, s’ériger en force politique transformatrice ? La question n’est pas seulement tactique ; elle engage la capacité d’un pays à inventer un horizon différent de la répétition des crises.
La jeunesse malgache détient le nombre, l’énergie et le désir de rupture. Mais sans structuration, sans projet partagé, sans alliance avec d’autres forces sociales, elle risque de demeurer une puissance latente, condamnée à l’impuissance politique.
Dans cette incertitude réside le paradoxe malgache : une jeunesse démographiquement hégémonique, mais politiquement marginalisée. À terme, la véritable menace pour le pouvoir de Rajoelina pourrait ne pas venir d’un soulèvement spectaculaire, mais d’un lent travail d’érosion, où l’écart croissant entre gouvernants et gouvernés fragilise les fondations mêmes de la légitimité politique.