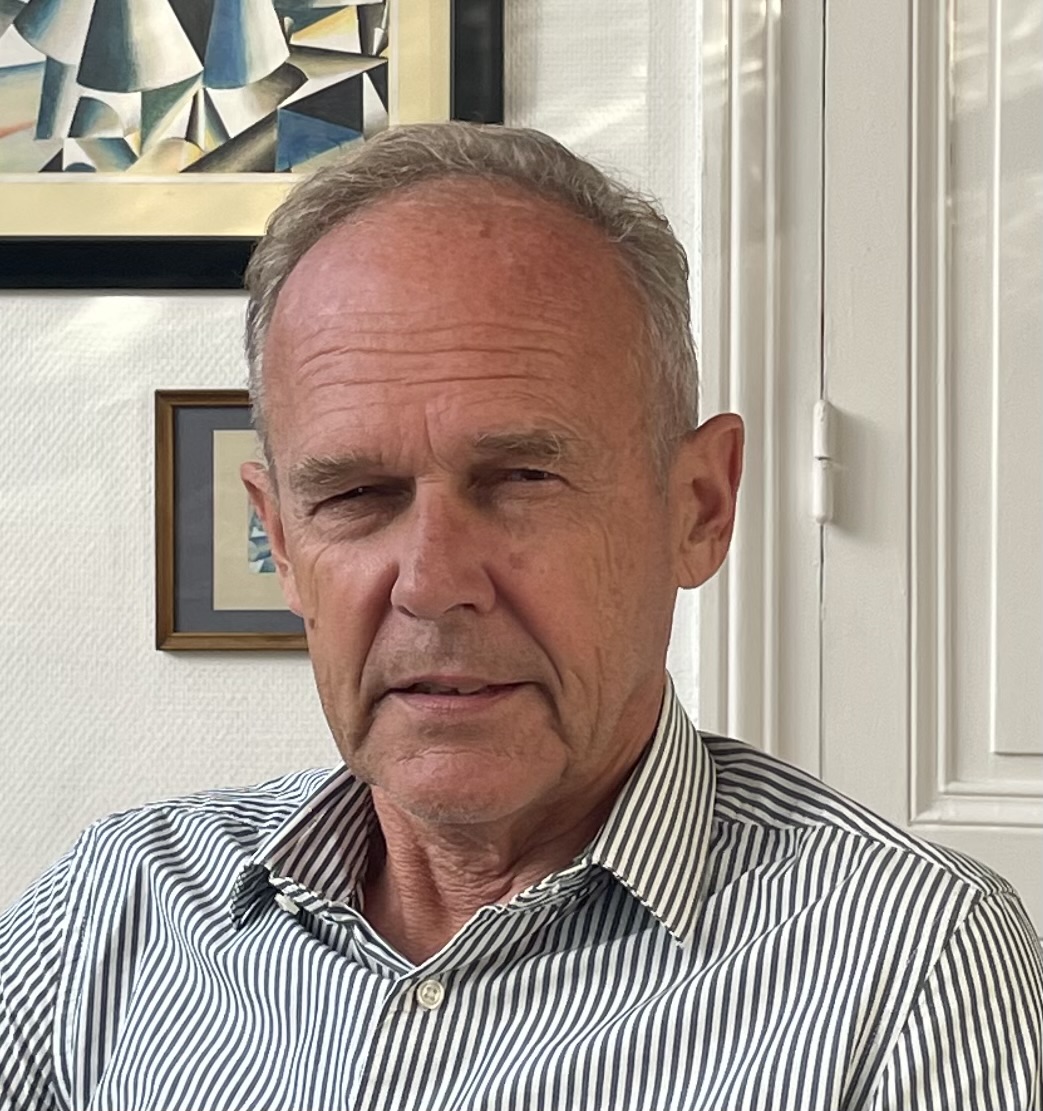Joseph Kabila condamné à mort pour trahison et crimes de guerre
Le 30 septembre 2025, la Haute Cour militaire de Kinshasa a rendu un verdict qui restera dans l’histoire : l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à mort par contumace pour trahison, crimes de guerre et soutien à un mouvement rebelle. Cette décision, sans précédent en Afrique centrale, interroge sur la capacité de la justice congolaise à solder l’héritage d’un passé violent, mais aussi sur les risques d’une instrumentalisation politique.
De l’homme fort au condamné
Pendant dix-huit ans, Joseph Kabila a incarné le pouvoir congolais. Propulsé à la tête de l’État en 2001, après l’assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, il a gouverné jusqu’en 2019 dans un climat marqué par les conflits armés à l’Est, les tensions communautaires et des accusations récurrentes de corruption.
Sa condamnation repose sur des liens supposés avec le groupe rebelle M23 et l’Alliance Fleuve Congo (AFC). Selon la justice militaire, il aurait soutenu des opérations armées contre les institutions nationales, organisé un mouvement insurrectionnel et couvert des exactions incluant torture, violences sexuelles et homicides. Le jugement prévoit aussi le versement de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts à l’État congolais et aux provinces meurtries du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.
Un procès symbole, mais à quel prix ?
La RDC avait rétabli la peine de mort en 2024, rompant avec un moratoire observé depuis plus de vingt ans. La condamnation de Kabila est donc aussi le fruit d’un tournant judiciaire majeur. Elle fait de lui le premier ancien chef d’État africain condamné à mort par une juridiction nationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Mais si ce jugement est salué par certaines ONG comme un pas vers la justice transitionnelle, d’autres dénoncent un procès biaisé. Le Front Commun pour le Congo (FCC), coalition proche de l’ancien président, parle de « mascarade judiciaire » destinée à écarter un adversaire encore influent. Le spectre de la vengeance politique plane donc sur cette affaire, au risque d’affaiblir la portée historique de la décision.
Entre mémoire et réconciliation
Le procès Kabila cristallise une question cruciale : comment la RDC peut-elle affronter son passé sans s’enliser dans une logique de règlement de comptes ? Le pays reste déchiré par les violences dans l’Est, où les groupes armés continuent de provoquer des déplacements massifs de population. Dans un tel contexte, la justice ne peut se réduire à la sanction : elle doit contribuer à une réconciliation nationale encore largement à construire.
La condamnation de Joseph Kabila, figure centrale de la mémoire politique congolaise, peut être interprétée comme un miroir tendu à la nation. Mais ce miroir est fragile. Il ne produira ses effets que si l’appareil judiciaire parvient à s’affirmer comme indépendant, transparent et orienté vers la vérité.
Un verdict fondateur ?
Pour la RDC, ce procès marque un moment de bascule. Il peut être lu comme une rupture avec une culture de l’impunité longtemps tolérée au sommet de l’État. Mais il peut aussi se transformer en un précédent dangereux si la justice militaire est perçue comme un outil du pouvoir en place.
Dans une Afrique centrale en quête de stabilité, où la mémoire des conflits reste vive et les équilibres régionaux fragiles, la condamnation de Joseph Kabila dépasse largement les frontières congolaises. Elle interroge le rapport entre justice et politique, vengeance et mémoire, légalité et légitimité.
L’avenir dira si cette sentence ouvre la voie à une refondation institutionnelle ou si elle ne restera qu’un épisode supplémentaire dans la longue chronique des fractures congolaises.