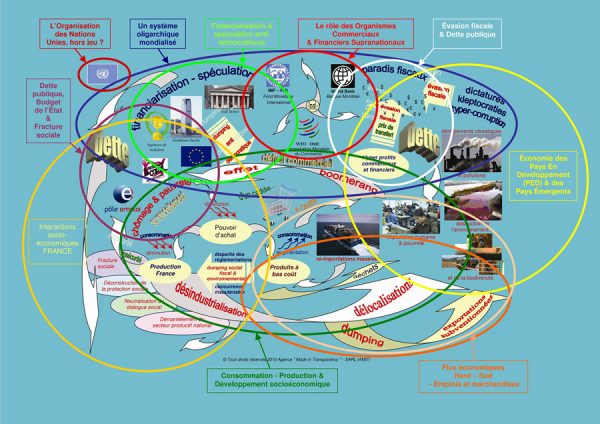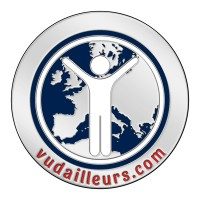Le protectionnisme est-il un gros mot ? En tout cas, ceux qui en défendent le principe sont carrément taxés de xénophobie économique alors qu’il ne s’agit, en réalité, que de se désengager d’une mondialisation dont les effets sont souvent pervers à l’échelle nationale. En fait, le protectionnisme est une décision volontaire et assumée d’isoler quelque peu sa propre économie nationale, afin de la protéger des turbulences globales et d’amoindrir les inévitables chocs dont la volatilité est foncièrement dévastatrice et sur l’investissement et sur la consommation. Pourtant, ses défenseurs sont honnis et c’est tout juste s’ils ne sont pas accusés de négationnisme économique, de prôner le retour aux sinistres années 1930, bref d’attiser l’angoisse populaire.
Néanmoins, quelles que soient les positions des uns et des autres, la globalisation –telle que nous l’avons connu au temps de splendeur vers la fin des années 1990 et le début des années 2000- a vécu, car elle n’est désormais plus productive ! Le commerce mondial n’est effectivement plus la locomotive de la croissance mondiale qu’il fut encore jusqu’à un passé récent. En conséquence, la globalisation et son extension naturelle qu’est l’accélération des échanges commerciaux ne s’avèrent plus tellement profitables aux économies. La raison est que –dans leur écrasante majorité- les économies occidentales ne sont plus dépendantes de la production industrielle. En outre, bien des industries semblent vouloir opter dans un avenir proche se relocaliser en Occident, au détriment de la Chine par exemple (selon un rapport récent du Boston Consulting Group).
Prenons conscience d’un phénomène fondamental, à savoir que ce n’est désormais plus tant nos responsables politiques qui décideront de l’intensification ou de la régression de la globalisation que les impératifs et les opportunités économiques. C’est en effet la technologie et son évolution qui définiront tout à la fois l’avenir de la production industrielle et le paysage économique de demain. L’Institut d’Etudes Stratégiques basé à Washington estime pour sa part que la production moderne et que les chaînes et réseaux liés à l’offre imposeront mécaniquement une régression de la globalisation.
Ce « protectionnisme naturel » sera donc un choix délibéré des acteurs économiques et ne sera en rien dicté par une quelconque politique publique ni par des menaces de sanctions ou amendes. La globalisation constituera donc une entrave à la production et au développement satisfaisant et harmonieux des entreprises de demain qui exigeront -dans leur propre intérêt- un recentrage à l’intérieur des frontières nationales. Cette dynamique de déglobalisation –ou d’essentialisation économique et financière- ne constituera en rien une menace au développement et à la prospérité pour la simple et unique raison que les emplois de demain seront de nature fondamentalement différents de ceux d’aujourd’hui. En effet, les tâches consistant à surveiller et à programmer les robots de demain ne ressembleront en rien –du point de vue de la connaissance et de la formation nécessaires- au type d’emplois ayant fui l’Occident vers la Chine.
La fin annoncée et inévitable de la globalisation ne sera donc nullement la catastrophe décrite par l’orthodoxie politico-économique. La déglobalisation et le protectionnisme seront la conséquence logique d’une adaptation des économies occidentales à l’essor fulgurant des technologies. Nul besoin, donc, de monter en rhétorique, de légiférer, de révoquer des traités et de proférer des menaces de rétorsion. En effet, pendant ce temps, le protectionnisme creuse son sillon, pour de simples motifs économiques.
Embrasser le protectionnisme par Michel Santi