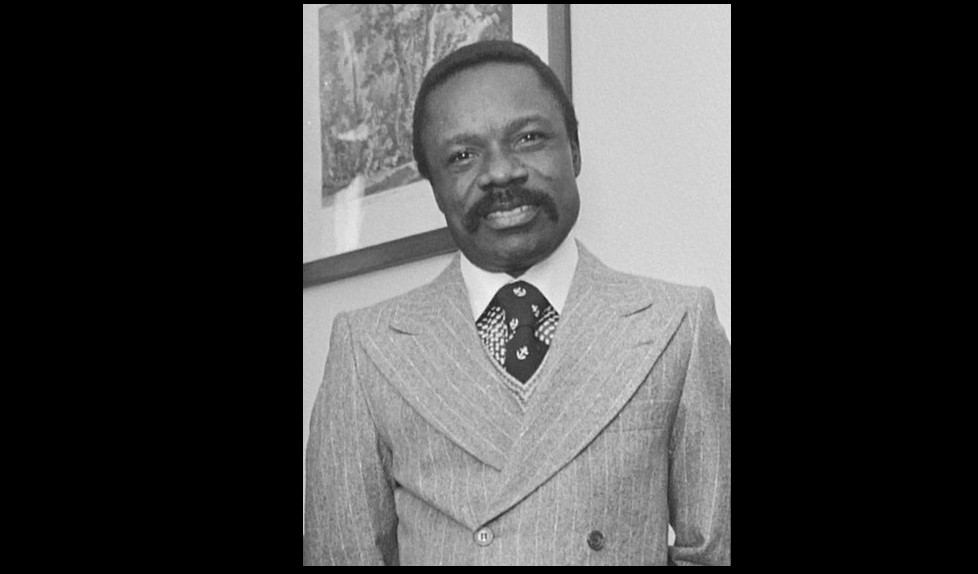Le peuple Ndoumou : mémoire d’une migration, genèse d’une cité
Dans les replis boisés du Haut-Ogooué, sur les rives sinueuses de la Mpassa, s’est établie une communauté dont l’histoire, transmise par la parole et le rite, éclaire les origines de Franceville : les Ndoumou. Leur langue, le Ndumu — aux multiples variantes orthographiques, témoins de sa transmission orale (Bandoumou, Doumbou, Ndumbo…) — demeure aujourd’hui encore difficile à quantifier, bien que certaines sources évoquent environ cinq mille locuteurs.
Une migration fondatrice
La tradition orale situe l’origine des Ndoumou à Otchadé, contrée sans forêt voisine du Congo, où ils cohabitent avec les Mbochi, les Haoussa et les Banboungoulou. Repoussés par les Mbochi, ils empruntent la Sébé, affrontent les Ambamba, et s’établirent sur les hauteurs de la Mpassa. Le chef Ndoumou, figure tutélaire, scella la paix par des alliances matrimoniales avec les peuples autochtones — Mbahouin, Bawoumbou, Oshashi Akanigui — contre une dot de trois cabris. Il fonda le village de Biki sur les collines d’Obounhou et d’Obiéné, lieux devenus mythiques dans la mémoire collective.
L’irruption de l’histoire coloniale
L’arrivée de Pierre Savorgnan de Brazza marque un tournant décisif. Remontant l’Ogooué avec trois compagnons, il atteint Mashokou, puis Biki, mis à sa disposition par le chef Nguimi. Brazza y érige deux cases — sur l’actuel emplacement de la maison de l’adjoint et du bureau régional — et baptise le lieu Francheville. Il pacifie les tribus, introduit un chariot dont les roues, brisées, obligent les Ndoumou à porter les charges jusqu’à Alékei, chez le chef téké Onyami. Puis il repart, laissant derrière lui les prémices d’une cité.
Le village de Biki se déplace sur l’autre rive de la Mpassa. Deux Européens, Oyez et Amiel, s’y installent brièvement. Trois ans plus tard, le commandant Potin prend le relais. La Société SHO s’implante, accompagnée du père Hée, premier missionnaire, figure emblématique de la mission Saint-Hilaire fondée vers 1890, et dont la tombe repose sur les berges de la Mpassa après soixante ans de vie gabonaise.
Une société matrilinéaire et clanique
La société Ndoumou est matrilinéaire : le nom se transmet par le père pour les garçons, par la mère pour les filles. Elle se structure autour de quatre clans principaux — Kouya (celui du chef Ndoumou), Kanandjogo, Nagni, Opigui — dont les chefs arborent une peau de chat-tigre (njourou), une calotte de raphia ornée d’une plume de perroquet, un chasse-mouches et une canne, instruments de la palabre et de l’autorité.
Leur religion, leurs techniques et leurs règles sociales s’apparentent à celles des Ambamba, soulignant une continuité culturelle dans la diversité ethnique du Haut-Ogooué.