La dette française, entre confiance et dépendance
Plus de la moitié de la dette publique française est aujourd’hui détenue par des investisseurs étrangers. Ce chiffre n’est pas nouveau, mais il soulève une question essentielle : que signifie, pour un État, voir sa dette circuler entre des mains multiples et souvent lointaines ?
Un rapport du Sénat rappelle que cette ouverture n’est pas forcément une faiblesse. Elle peut aussi être un signe de confiance et d’attractivité. Dans les pays développés, la dette publique reflète toujours un équilibre entre investisseurs nationaux et étrangers. La diversité des porteurs – banques centrales, fonds de pension, compagnies d’assurance – dessine une carte financière qui touche directement la souveraineté.
Comment l’État finance sa dette
L’État émet régulièrement des titres : bons du Trésor à court terme et obligations assimilables du Trésor (OAT) à moyen et long terme. L’Agence France Trésor organise ces adjudications avec un cercle de banques d’investissement, dont quatre françaises pour la période 2025‑2027.
Une fois émis, les titres circulent librement sur les marchés. L’État ne dispose donc que d’une vision globale de ses créanciers, grâce aux enquêtes de la Banque de France et du FMI. Pour 2026, le programme de financement prévoit 310 milliards d’euros.
Une internationalisation stabilisée
À la fin du XXe siècle, moins d’un tiers de la dette française était détenue par des non-résidents. La mondialisation et la création de la zone euro ont changé la donne. En 2009, ce taux atteignait 66,4 %. Depuis, il oscille entre 50 et 60 %.
Au premier trimestre 2025, les investisseurs étrangers détenaient 54,7 % de la dette négociable, soit près de 2 800 milliards d’euros. La moitié de ces porteurs se trouvent en zone euro. Ce niveau rapproche la France de l’Allemagne, mais reste inférieur à celui des États-Unis ou du Japon.
Diversification et souveraineté : un équilibre fragile
La diversification des porteurs apporte une stabilité. En effet, elle élargit la demande, réduit les taux d’émission et confirme l’attractivité de la signature française. Cependant, une question demeure : jusqu’où la souveraineté peut-elle supporter une dépendance aux capitaux étrangers ?
Le rapport du Sénat met en garde. Orienter la dette vers l’épargne nationale coûterait cher, avec des avantages fiscaux ou des taux bonifiés. Cela détournerait aussi l’épargne des actions, affaiblissant la capacité des entreprises françaises à se financer.
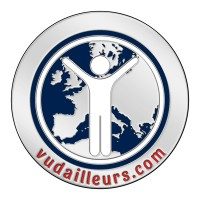






Un commentaire