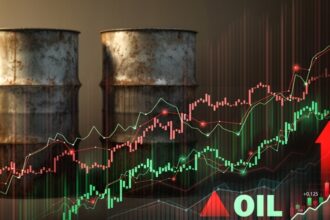Il flotte aujourd’hui dans les banques françaises un parfum de fin de règne, une atmosphère lourde où se mêlent lassitude, colère froide et sentiment d’abandon. Le secteur bancaire, autrefois symbole de stabilité et de respectabilité, se découvre un climat social digne d’une industrie en déclin. Les dirigeants parlent de transformation, de modernisation, de compétitivité. Les salariés, eux, parlent de survie.
Le contraste est saisissant. Alors que les établissements affichent des résultats confortables, les plans sociaux se succèdent avec une régularité presque mécanique. Chez BNP Paribas, le plan de départ volontaire a été présenté comme une opération “douce”, presque indolore. En réalité, il a agi comme un révélateur : même la première banque de la zone euro n’échappe plus à la logique du dégraissage permanent. On ne licencie pas, certes, mais on pousse vers la sortie. Et chacun comprend le message.
Le malaise n’est pas cantonné à une seule enseigne. Au Crédit Agricole, pourtant réputé pour sa culture interne plus consensuelle, une grève inédite a éclaté. Un événement rarissime dans une maison qui se targuait d’être un modèle de dialogue social. Quand même les bastions les plus paisibles se mettent à trembler, c’est que la fissure est profonde. Les salariés dénoncent une pression commerciale devenue insupportable, une bureaucratie numérique qui étouffe le métier, et une direction qui semble avoir troqué l’écoute contre des tableaux de bord.
Quant à la Société Générale, elle poursuit ses suppressions de postes avec une détermination qui confine à l’acharnement. Les restructurations y sont devenues un mode de gouvernance, presque une habitude culturelle. On ferme, on fusionne, on externalise. Les salariés, eux, encaissent. Jusqu’à quand ? La banque rouge et noire, déjà fragilisée par des années de turbulences, semble avoir fait de la réduction d’effectifs son unique boussole stratégique.
Ce qui frappe, au-delà des chiffres, c’est l’impression d’un secteur qui ne croit plus en lui-même. Les dirigeants jurent que la digitalisation est la voie du salut, mais elle sert trop souvent de prétexte à une rationalisation brutale. Les agences ferment, les métiers se vident de leur substance, la relation client se dissout dans des interfaces. Le conseiller bancaire, autrefois figure de confiance, devient un exécutant surveillé, évalué, pressuré. On lui demande d’être à la fois psychologue, commercial, technicien, tout en lui retirant les marges de manœuvre qui faisaient la noblesse du métier.
Le climat social est tendu parce que les salariés ont le sentiment d’être les variables d’ajustement d’une industrie qui ne sait plus où elle va. Ils voient les profits, mais pas la reconnaissance. Ils entendent les discours sur la “transformation”, mais constatent surtout la dégradation de leurs conditions de travail. Ils subissent des objectifs toujours plus élevés, des outils toujours plus intrusifs, des restructurations toujours plus fréquentes.
La vérité, c’est que les banques françaises vivent une crise identitaire. Elles veulent être des fintechs sans en avoir l’agilité, des géants industriels sans en assumer la brutalité, des institutions de confiance tout en sacrifiant la relation humaine. Cette incohérence se paie aujourd’hui dans les couloirs, les open spaces, les agences désertées. Elle se paie en colère, en résignation, en départs silencieux.
Le secteur bancaire aime à rappeler qu’il est essentiel à l’économie. Il serait temps qu’il se souvienne qu’il repose d’abord sur des femmes et des hommes. Sans eux, pas de confiance. Sans confiance, pas de banque. Et ce n’est pas un plan de départ volontaire de plus, une grève exceptionnelle ou une vague de suppressions de postes qui viendra masquer cette évidence.