Le 25 novembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt majeur concernant le mariage homosexuel en Europe. Elle a estimé que tout État membre de l’Union européenne est tenu de reconnaître une union homosexuelle conclue dans un autre pays de l’Union. La décision concernait un couple polonais marié en Allemagne, mais dont l’union n’était pas reconnue à Varsovie.
Pour la CJUE, ce refus constitue une entrave à la liberté de circulation en Europe et viole le droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges soulignent que cette situation entraîne des « inconvénients administratifs, professionnels et privés » et contraint les époux à vivre comme célibataires dans leur pays d’origine.
Si l’argument juridique est solide, il illustre une tension croissante entre l’uniformisation des droits LGBT en Europe et la souveraineté nationale. En Pologne, où la société reste largement conservatrice sur les questions sociétales, l’arrêt est perçu comme une immixtion dans les mœurs nationales. Montesquieu rappelait que « un pays est fait bien plus de ses coutumes que de ses lois » : l’écart entre la norme juridique européenne et les sensibilités locales apparaît ici dans toute sa netteté.
À droite, plusieurs responsables politiques polonais ont dénoncé une atteinte à la souveraineté polonaise, certains allant jusqu’à évoquer un Polexit. La Pologne, aux côtés de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Slovaquie, demeure l’un des rares pays européens à n’avoir légalisé ni le mariage gay ni l’union civile pour les couples de même sexe.
Cet arrêt illustre ainsi le dilemme fondamental de l’Union européenne : comment concilier l’affirmation d’un espace juridique commun avec le respect des identités nationales et des sensibilités culturelles ? La CJUE, en privilégiant la logique des droits fondamentaux, accentue une fracture qui nourrit le scepticisme croissant des peuples vis-à-vis du projet européen.
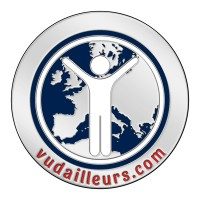






Un commentaire